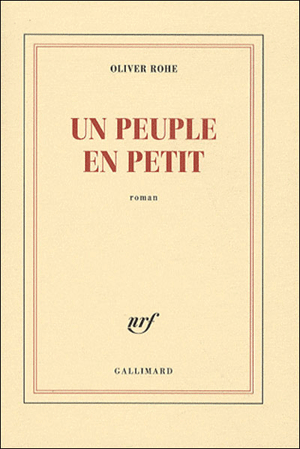 Un peuple en petit d’Olivier Rohe (éd. Gallimard)
Un peuple en petit d’Olivier Rohe (éd. Gallimard)
Bochum (386 499 habitants en 2005) est une ville d’Allemagne dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie au sein d’une vaste bassin houiller (merci Wikipédia). Bochum, la ville et ses incontournables écoles de théâtre est certainement le personnage 1 du roman d’Olivier ROHE « Un peuple en petit ». Car le « personnage 2 » est un voisin de pallier (sorti de la vie mode d’emploi de Perec ?) Économiquement, Bochum a connu la crise de l’industrie charbonnière dès les années 1950. Elle a entrepris une reconversion notamment avec l’implantation d’une grande usine automobile d’Opel, créée en 1962. Mais l’auteur a choisi la période 79-89 comme toile de fond ou peut-être comme personnage à part entière. On est loin de l’auto-fiction qui intéressa l’auteur un temps. La forme est déstructurée, les scènes courtes. L’enfant qui traverse le roman vit lui, dans une guerre sans nom. Mais c’est à personnage 2 que je me suis attaché. Cet homme en mal de mots. Il ne trouve jamais le bon. Se trompe. Doute. Plus que jamais, je me dis que cet étrange livre aura autant de lectures qu’il aura de lecteurs. Certains j’imagine seront agacés par les codes volontairement perturbés par Olivier Rohe. D’autres disent déjà qu’il un faiseur, tandis que Télérama se pâme. Que me restera-il de cette lecture. Finalement beaucoup d’interrogations bien au-delà du plaisir… C’est bien, non ?
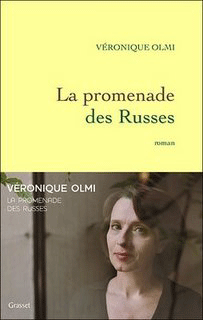 La promenade des Russes de Véronique Olmi (éd. Grasset)
La promenade des Russes de Véronique Olmi (éd. Grasset)
Plaisir amusé du florilège qui présente des auteurs aussi différents que ROHE et OLMI !
Là nous sommes à présent dans une littérature « attendrissante ». Ca peut paraître dur pour Olmi mais pourtant, je m’en rends compte au fil des rencontres avec les lecteurs, le besoin est grand de décaler sans cesse les styles, genres et écritures pour continuer à se laisser surprendre par des personnalités différentes ! Ici l’auteur, qui écrit également du théâtre, offre une maîtrise de « la formule » qui fait mouche : .« Qu’est-ce qu’elle voit dans ses cartes, puisqu’elle n’a pas d’avenir et qu’elle n’a jamais gagné une réussite sans tricher ? ». L’ensemble est très plaisant à lire.
Résumé de l’éditeur : L’héroïne de ce roman est une très jeune fille, Sonia, qui vit à Nice avec sa grand-mère russe. Comme toutes les « babouchkas » de la Côte d’Azur (lieu d’exil favori des Russes blancs après la Révolution d’octobre), celle-ci se partage entre samovars, rêveries et nostalgie du paradis perdu. De fait, la petite Sonia ne sait pas vraiment à quel monde elle appartient : celui de sa réalité quotidienne, avec une mer trop bleue et les commerçants de la vieille ville ? Ou celui de ses songes, orchestrés par sa babouchka, avec ses neiges étincelantes et ses fastes tsaristes ? Prudente, elle s’est donc réfugiée dans un imaginaire très personnalisé où l’on retrouve les héroïnes romanesques de Daphné du Maurier et le Mystère Anastasia – cette jeune princesse qui, dit-on, échappa au massacre de la famille impériale…
On suit ainsi son éducation sentimentale et morale entre deux mondes distincts. Il y a là le pittoresque du midi et le tourment slave ; des odeurs mêlées d’ail et de thé ; des douleurs causées par une mère absente et des remèdes imaginés par une grand-mère qui, pour survivre, adore (se) mentir à elle-même et aux autres…
Roman de ton, d’atmosphère et de sensation, variation sur le thème de la vérité, de l’histoire, des sentiments, La promenade des Russes est porté avec grâce par la prose ironique et douce de Véronique Olmi qui ruse habilement avec sa propre biographie.
Extrait : « La vérité est ailleurs. La vérité est en face de moi. Mais pas dans le magazine avec Ingrid Bergman. Pas dans les cartes. La vérité est dans la tête de ma grand-mère. Elle ne l’a jamais dite à personne. Même aux journaux. Même aux présidents. Elle se croit encore en danger, elle se livre à mi-mots, elle balance des demi-vérités, persuadée que Iouri Andropov lit par-dessus son épaule, aussi personne prend la peine de glisser des félicitations dans l’enveloppe réponse. C’est pas grave. Je suis en première ligne. Et j’attends. Si j’ai une utilité sur cette terre où je suis arrivée terriblement en retard, c’est sûrement celle-là : attendre que la vérité éclate. Que ma grand-mère me fasse confiance. »
Véronique Olmi a publié plusieurs romans (Bord de mer, Numéro Six, Un si bel avenir, La pluie ne change rien au désir, Sa passion) et des pièces de théâtre (de Chaos debout au Jardin des apparences ou, plus récemment, Mathilde et Je nous aime beaucoup) qui sont jouées partout en Europe.
Je conseille en particulier la lecture de NUMÉRO SIX, un texte fort.
 Renaissance italienne d’Éric Laurrent (éd.Minuit)
Renaissance italienne d’Éric Laurrent (éd.Minuit)
Laurrent le magnifique ?
« De retour de Florence, où j’étais allé passer une dizaine de jours pour oublier Clara Stern, je ne pouvais imaginer que le destin me ramènerait en Toscane quelque neuf mois plus tard – et encore moins que j’y trouverais l’amour. » (Extrait)
Ici on baigne dans un luxe que l’on souhaiterait partagé par le lus grand nombre. Il n’en est rien. Le protagoniste du nouveau livre d’Éric Laurrent ne semble pas touché par la crise ! Juste une crise d’identité amoureuse. Il part à la recherche d’une femme en rencontre une autre… Bref ce n’est pas le scénario qui retient mon attention mais l’écriture assez belle. L’auteur nous fait partager son goût pour la peinture du XIXe (les nus féminins en particulier). On parle ici une langue délicate, on « florentise » un Paris réinventé pour l’occasion. Florence c’est toute la renaissance italienne, les Medicis avec Laurent le Magnifique, Machiavel… et bien d’autres !
(…) le narrateur décortique sans cesse tant et si bien les choses – les piégeant dans son langage comme pour mieux les immobiliser, puis les analyser comme une araignée décortique les insectes qu’elle prend dans sa toile – qu’il va, jusqu’à la fin, s’y perdre lui-même, risquant de laisser sa « proie » (la jeune femme) disparaître intacte de sa vie. C’est à cela qu’on reconnaît qu’on aurait tort de réduire Eric Laurrent à son langage précieux, à ses mots rares, comme s’il s’agissait d’un érudit qui pontifie. Son alter ego en est tout le contraire : un antihéros qui dresse entre la vie et lui un épais mur de mots, un écran aussi opaque que La Princesse de Clèves (puisque la langue de Renaissance italienne en a parfois la texture, la tournure), ce magnifique et très morbide monument de l’évitement. Comment, alors qu’on aime, sortir de l’envoûtement, de la prison des mots pour s’autoriser le geste, c’est-à-dire la vie ? Il faudra compter sur le personnage féminin pour entrer quasiment par effraction dans le système clos d’un narrateur impuissant à vivre.(…)
Nelly Kaprièlian, Les Inrockuptibles, 18 mars 2008
